Histoire des médias : l’évolution de la télévision comme média d’information
Des premières images en noir et blanc aux chaînes d’info en continu et aux plateformes de streaming, la télévision a profondément transformé notre manière de nous informer. Média de masse par excellence, elle a imposé ses images, ses grands rendez-vous d’actualité et ses figures emblématiques dans le quotidien de millions de téléspectateurs.
Dans cette rubrique “Histoire des médias”, l’EFJ revient sur la façon dont la télévision est passée de simple curiosité technique à un média d’information incontournable, aujourd’hui au cœur d’un écosystème où coexistent chaînes traditionnelles, plateformes numériques et réseaux sociaux.
Aux origines : la télévision, spectacle avant d’être média d’info

Avant de devenir un réflexe pour suivre l’actualité, la télévision est d’abord une innovation technologique. Les premières expériences de transmission d’images datent du début du XXᵉ siècle, mais c’est surtout après la Seconde Guerre mondiale que la TV commence à s’installer dans les foyers.
Au départ, elle est avant tout un média de divertissement :
retransmissions de spectacles et d’événements sportifs
émissions de variétés,
fictions et feuilletons.
L’information continue à être diffusée principalement par la presse écrite, la radio et les actualités filmées au cinéma. La télévision n’est encore qu’un complément, fascinant mais minoritaire, dans le paysage médiatique.
La naissance de l’info télévisée : l’invention du journal télévisé
Le véritable basculement intervient lorsque la télévision invente ses propres formats d’information. En France, le premier journal télévisé est diffusé le 29 juin 1949, à 21h, pour une quinzaine de minutes. Présenté par Pierre Sabbagh, ce JT marque le début d’un rendez-vous régulier entre les téléspectateurs et l’actualité en images.


Ce journal télévisé s’inspire de plusieurs sources :
la presse écrite, pour le choix et la hiérarchie des sujets ;
les actualités filmées, pour l’usage des images tournées sur le terrain ;
la radio, pour le ton, la structure et le rythme de présentation.
Très vite, le JT devient un moment clé de la journée, un rendez-vous familial qui rythme les soirées. Les grandes rédactions TV se structurent, les salles de rédaction s’équipent et la télévision s’impose peu à peu comme un média central pour “voir” l’actualité, et plus seulement l’entendre ou la lire.
Des grandes soirées d’info aux chaînes d’information en continu
À partir des années 1960-1970, la télévision devient le média des grands événements :
élections et soirées électorales,
événements historiques (discours politiques, crises, chutes de régimes),
exploits sportifs retransmis en direct,
grands faits de société, catastrophes ou mobilisations.
Les téléspectateurs s’habituent à vivre l’actualité “en temps réel”, grâce à la montée en puissance des directs, des duplex et des éditions spéciales.
Une nouvelle étape est franchie avec la naissance des chaînes d’information en continu. En 1980, CNN devient la première chaîne “tout-info” 24h/24, imposant un nouveau tempo pour la couverture de l’actualité, fondé sur la réactivité permanente, les “breaking news” et l’analyse en plateau.
En France, des chaînes comme BFM TV, CNews, LCI ou franceinfo: TV reprennent ce modèle de l’info en continu. Leur regroupement récent sur des canaux voisins de la TNT illustre à quel point ces chaînes structurent désormais la compétition autour de l’information télévisée.
Révolution numérique : de la TNT à l’Ultra HD et au streaming
Sur le plan technique, la télévision connaît, elle aussi, une révolution numérique.
Quelques étapes clés :
la généralisation de la télévision numérique terrestre (TNT), qui remplace progressivement l’analogique et multiplie le nombre de chaînes disponibles
le passage de la TNT à la haute définition (HD) en 2016 en France, qui améliore nettement la qualité d’image
l’arrivée plus récente de l’Ultra Haute Définition (UHD) sur la TNT, qui marque une nouvelle étape dans la modernisation de la diffusion
Parallèlement, les usages évoluent : les plateformes de streaming vidéo s’imposent comme des acteurs majeurs de l’audiovisuel, et les téléviseurs connectés permettent d’accéder aussi bien aux chaînes traditionnelles qu’aux services à la demande.
Pour autant, la télévision reste un pilier de la consommation vidéo : selon une étude récente, elle demeure le premier support pour regarder des vidéos, même si le smartphone est désormais l’équipement le plus présent dans les foyers et particulièrement plébiscité par les 15-24 ans.
Télévision, réseaux sociaux et vidéos en ligne : un écosystème d’images
Aujourd’hui, l’information télévisée ne se limite plus à l’écran du salon. Les extraits de journaux télévisés, de reportages et de magazines d’actualité circulent massivement sur :
les réseaux sociaux (Instagram, X/Twitter, TikTok, Facebook),
les plateformes vidéo (YouTube, plateformes des groupes TV),
les sites d’info et applications mobiles des chaînes.
Les chaînes réinventent leurs formats pour ces nouveaux supports :
séquences courtes et sous-titrées pour être vues sans le son,
“reels” et “shorts” qui résument un sujet en quelques secondes,
formats longs mis en ligne en replay ou en intégralité.
Pour les journalistes, cela signifie travailler dès le départ avec une logique plurimédia : penser un sujet pour le JT, mais aussi pour le web, le mobile et les réseaux sociaux.



Pourquoi la télévision reste un média clé pour les journalistes ?
Malgré la concurrence des plateformes numériques et l’émergence de nouveaux usages, la télévision garde des atouts majeurs dans le paysage de l’information :
La force de l’image : la vidéo permet de montrer le réel, de rendre visibles des situations, des lieux et des visages qui marquent durablement le public.
Le direct : la TV excelle dans la couverture en temps réel des événements (élections, conflits, manifestations, crises), avec des équipes déployées sur le terrain et en plateau.
La pédagogie par l’image : infographies animées, cartes, reconstitutions et décryptages rendent l’information plus accessible à un large public.
La crédibilité des grandes rédactions : comme pour la radio, les rédactions TV structurées, dotées de journalistes spécialisés, restent des références en matière de vérification et de hiérarchisation de l’info.
La puissance de frappe : un sujet diffusé dans un grand JT ou une émission d’investigation peut toucher plusieurs millions de personnes en une seule soirée.
Pour les futurs journalistes, la télévision demeure donc un terrain d’expression privilégié, où se combinent écriture, incarnation, sens de l’image et maîtrise des outils techniques.
Se former aux métiers de la télévision avec l’EFJ
À l’EFJ, la télévision n’est pas abordée de manière théorique : les étudiants se forment au cœur d’un environnement professionnel, avec un studio TV et une newsroom qui reproduisent les conditions d’une vraie rédaction.
Au fil du cursus, ils apprennent à :
préparer et présenter un journal télévisé en plateau ;
-
tourner des reportages sur le terrain, en binôme ou en JRI (journaliste reporter d’images) ;
écrire pour l’image : lancements, commentaires, voix off, titrages ;
maîtriser la chaîne technique : cadrage, prise de son, lumière, montage ;
adapter un sujet TV pour le web et les réseaux sociaux, en formats courts ou longs ;
travailler en équipe dans une logique de conférence de rédaction, de conducteur et de timing en direct.
Des ateliers TV et des masterclasses avec des professionnels de la télévision viennent compléter cette formation, en offrant aux étudiants un contact direct avec le terrain et les attentes des rédactions actuelles.
Devenir journaliste télé : et si c’était vous ?
L’évolution de la télévision montre une chose : malgré les mutations technologiques et l’essor du numérique, l’image reste au cœur de l’information. Se former au journalisme télé, c’est apprendre à :
raconter le monde en images,
décrypter l’actualité pour le plus grand nombre,
inventer de nouveaux formats à l’ère des plateformes et des réseaux sociaux.
Si vous vous imaginez déjà en reportage avec une caméra sur l’épaule, en train de décrypter l’actualité en plateau ou de monter votre sujet pour le JT, c’est peut-être que les métiers de la télévision sont faits pour vous.
-
découvrez les métiers liés à la télévision et au journalisme télé sur le site de l’EFJ
-
enseignez-vous sur la formation en journalisme plurimédia proposées par l’EFJ, qui préparent aux rédactions TV, mais aussi à la radio, à la presse et au web
-
et, si vous souhaitez faire de votre passion pour l’info et la vidéo un métier, candidatez en ligne pour rejoindre l’EFJ et construire votre projet professionnel dans l’univers de la télévision.
Voir d'autres actualités
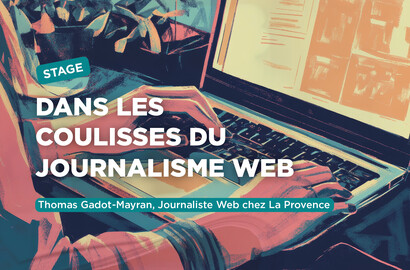
Thomas, étudiant EFJ, en stage à La Provence à Marseille : dans les coulisses du journalisme web
Quand on imagine un stage en rédaction, on pense souvent “reportage”, interviews sur le terrain, micro-trottoirs… La réalité du journalisme web, elle, commence parfois ailleurs : face aux dépêches d’agence, au rythme de l’actualité chaude, avec un objectif très clair : informer vite, bien, et dans un format parfaitement adapté au numérique.Thomas, étudiant à l’EFJ, effectue son stage à La Provence à Marseille. Il y occupe un rôle clé dans la mécanique quotidienne d’un média : journaliste web. Son témoignage dit beaucoup du métier, de ses exigences, et de ce qu’un stage professionnalisant peut apporter quand on veut devenir journaliste.
lire la suite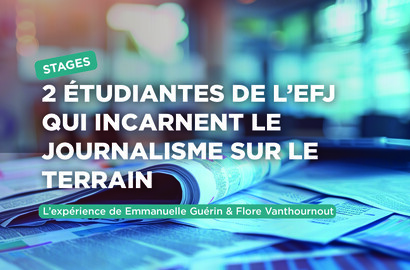
Deux étudiantes de l’EFJ qui incarnent la passion du journalisme sur le terrain
À l’EFJ, la formation au journalisme ne se limite pas aux salles de cours. Dès la première année, les étudiants sont plongés dans la réalité du métier : reportages, enquêtes, stages, projets encadrés… Deux profils incarnent cette pédagogie du journalisme par la pratique : Emmanuelle Guérin, en première année, et Flore Vanthournout, en troisième année à l’EFJ Bordeaux. Deux parcours différents, un même engagement : celui d’apprendre en faisant.
lire la suite
100% crise : nos étudiants de l’EFJ Bordeaux plongés en pleine tempête médiatique
Récemment, les étudiants de l’EFJ Bordeaux ont vécu une soirée hors du commun avec l’atelier 100% crise. Un exercice immersif, pensé comme une véritable mise en situation professionnelle, qui les a confrontés à une crise médiatique de grande ampleur. Le point de départ ? Une photo volée circulant sur les réseaux sociaux, une marque de cosmétiques bio dans la tourmente, et une seule question pour nos jeunes journalistes : comment informer avec rigueur, éthique et sang-froid quand tout s’emballe ?
lire la suiteVoir également