Consommation médias & réseaux sociaux des futurs journalistes de l’EFJ (Étude 2025)
Méthodologie en bref
Questionnaire auto‑administré auprès de 43 répondants. Les questions portaient sur les réseaux utilisés régulièrement, le temps passé, les formats d’information préférés, l’écoute de podcasts, la consommation de lives et les sources principales (médias/plateformes/comptes). Les pourcentages évoqués sont exprimés à partir de cet effectif.
Un trio qui structure les usages : Instagram, YouTube, TikTok
Dans les usages quotidiens, Instagram (40/43) devance YouTube (38/43) et TikTok (30/43). L’ordre n’a rien d’anodin :
Instagram est vécu comme une porte d’entrée de l’info, des tendances et de la culture visuelle. C’est souvent le premier réflexe d’ouverture, celui des Stories, des Reels et des carrousels explicatifs.
YouTube reste la plateforme du temps long : documentaires, enquêtes, formats pédagogiques et décryptages y prospèrent. Les Shorts servent de tremplin vers les vidéos longues.
TikTok incarne la découverte ultrarapide : codes narratifs très incarnés, cycles de diffusion accélérés, possibilité de « feuilletonner » l’actualité.
Les autres plateformes s’installent dans des rôles plus ciblés : LinkedIn (15/43) pour le personal branding et la veille professionnelle ; X (Twitter) (12/43) pour le temps réel et la surveillance de sources ; Facebook (8/43) demeure présent mais marginal auprès de l’échantillon.
Côté temps passé, la moyenne s’établit à 1h55 par jour (médiane : 2 h), avec une amplitude allant d’1 h à 4 h. Autrement dit, une pratique régulière mais maîtrisée, compatible avec une veille éditoriale structurée.
.jpg)

.jpg)

L’émergence d’un nouvel écosystème éditorial porté par les plateformes
D’abord vus comme de simples relais d’audience, les réseaux sociaux deviennent dès la fin des années 2000 un terrain d’enquête, de veille et de diffusion. Twitter/X s’impose pour le temps réel (ex: breaking news), Instagram puis TikTok pour le récit visuel et l’explication courte, YouTube et Twitch pour le décryptage long et les lives interactifs. Les rédactions intègrent alors la social listening, l’UGC (contenus d’utilisateurs) et l’OSINT dans leurs méthodes, avec des protocoles de vérification (géolocalisation, métadonnées, recoupements) et de modération renforcés.
Parallèlement, l’algorithme remplace la page d’accueil : il faut optimiser format, rythme, titraille et engagement sans céder au sensationnalisme. Émerge aussi la figure du journaliste-créateur, qui construit sa communauté et monétise certains formats (newsletters, vidéos, lives) tout en respectant les standards éthiques.
Résultat : les plateformes ne sont plus seulement des vitrines, mais des portes d’entrée de l’info et des espaces de production à part entière.
Comment s’informent‑ils ? L’écrit reste le socle, la vidéo pousse fort

À la question des formats préférés pour s’informer, les répondants plébiscitent d’abord les articles en ligne (37 citations). La vidéo n’est pas loin : formats courts (TikTok, Reels, Shorts) avec 30 citations et vidéos longues (YouTube, plateformes) avec 26 citations.
Les réseaux sociaux « en général » (25) sont cités comme vecteurs d’accès à l’info, quand la presse écrite (16) et les podcasts / audio (14) complètent le dispositif. En creux, un modèle se dessine : découverte via les fils sociaux et formats courts, approfondissement via l’article ou la vidéo longue. Cette complémentarité n’oppose pas les pratiques : elle les enchaîne dans une véritable chaîne de valeur éditoriale.
Podcasts et lives : deux compléments d’usage bien installés
Près de 6 répondants sur 10 déclarent écouter des podcasts. Les thématiques Actualité et Journalisme arrivent en tête, épaulées par la Culture (cinéma, musique), le divertissement et le talk. Côté live, la hiérarchie est nette : Twitch (16 citations) devance YouTube Live (11) et TikTok Live (5).
Le live n’est pas seulement un format : c’est un moment communautaire, propice au Q&A, au fact‑checking en direct et aux débriefs.

Quand l’audio à la demande transforme les rédactions
Nés dans les années 2000 avec le RSS et iTunes, les podcasts restent confidentiels jusqu’au tournant 2014 marqué par Serial, qui prouve qu’on peut faire de l’enquête longue et capter un public massif en audio à la demande. Dès lors, les rédactions créent des formats natifs : briefs quotidiens (le “daily” d’actu), décryptages thématiques, récits documentaires et investigations en plusieurs épisodes.
L’audio devient un canal d’intimité (écoute au casque), peu coûteux, compatible mobile et multitâche, avec des modèles de monétisation mêlant publicité, sponsoring, abonnements et bundles (newsletter + audio). En France, l’essor est porté par les radios (Radio France, Franceinfo) et des studios/ médias (ARTE Radio, Louie, Binge, Mediapart, etc.).
Résultat : le podcast s’impose comme pilier éditorial crédible, idéal pour donner du temps au temps, fidéliser une communauté et diversifier les revenus des médias.
Quelles sources principales ? Entre marques médias et créateurs d’actualité
Quand on demande des plateformes/comptes considérés comme « source principale », les étudiants citent d’abord Le Monde, puis Instagram (comme porte d’entrée), Hugo Décrypte, YouTube, Mediapart, X (Twitter), L’Équipe, le New York Times et ARTE. Le message est clair : les marques médias de référence cohabitent avec des figures éditoriales incarnées. La crédibilité et l’attachement de marque se jouent autant dans l’identité (journalistes/créateurs) que dans la qualité du label média.
.jpg)

.jpg)
Les futurs journalistes de l’EFJ évoluent dans un écosystème hybride, plurimédia : ils découvrent l’actualité sur les réseaux (Instagram, TikTok), s’orientent vers des formats longs (YouTube, articles) pour comprendre, et s’agrègent en communauté autour du live (Twitch).
Plutôt qu’une opposition des formats, leur pratique compose un parcours d’information complet : du signal au sens. À l’échelle de l’école, l’enjeu est d’accompagner ces usages par des exercices éditoriaux multi‑plateformes, des routines de veille exigeantes et des rendez‑vous en direct qui donnent à voir le journalisme en train de se faire.
Envie de devenir journaliste ? Candidatez à l’EFJ
Prêt à transformer vos usages des réseaux en compétences journalistiques ?
À l’EFJ, vous apprendrez à hiérarchiser l’info, raconter sur tous les formats (articles, vidéos, lives) et développer votre réseau pro.
Voir d'autres actualités
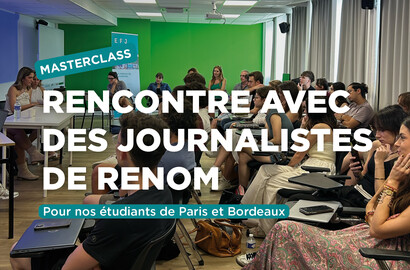
Des journalistes de renom à la rencontre de nos étudiants à Paris et Bordeaux
À l’EFJ, le journalisme s’apprend en le pratiquant, mais aussi en dialoguant avec celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Nos étudiants de Paris et Bordeaux ont récemment eu la chance de rencontrer plusieurs journalistes de renom, venus partager leur expérience, leurs parcours, mais aussi les réalités d’un métier en perpétuelle évolution.Deux rencontres, deux campus… mais un point commun : la passion du journalisme.
lire la suite
Stage au cœur de L’Équipe : une immersion enrichissante pour Klervia
Étudiante en 2e année à l’EFJ sur le campus de Paris, Klervia Lelong a effectué un stage de 3 mois au sein du service iconographie du journal L’Équipe. Une expérience immersive qui lui a permis de découvrir un univers professionnel inédit et de confirmer son appétence pour le terrain.
lire la suite
"Pop Your Mind" : la nouvelle génération de journalistes de l'EFJ fait vibrer Twitch autour de la santé mentale
29 étudiants, 2 semaines de préparation intense, 6 heures de direct : nos étudiants de l’EFJ Bordeaux ont relevé un défi de taille en imaginant et produisant entièrement "Pop Your Mind", une émission diffusée en live sur la plateforme Twitch. À travers ce projet, ils ont exploré un sujet aussi sensible que passionnant : la santé mentale à travers le prisme de la pop culture.
lire la suiteVoir également